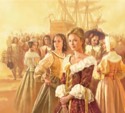Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Birth23 Mar 1644, Brouage, Rochefort, France
Burial7 Dec 1709, Saint-Enfant-Jésus, Pointe-Aux-Trembles, Québec, Canada2
FlagsBiography, Fille du Roi
FatherPierre Faucon
MotherAntoinette Berger
Spouses
Death23 May 1707, Pointe-Aux-Trembles, Île De Montréal, Québec, Canada13
Burial23 May 1707, Saint-Enfant-Jésus, Pointe-Aux-Trembles, Québec, Canada2
OccupationTailleur d’Habit
FlagsBiography, La Grande Recrue de 1653
MotherMarguerite Loiselle
Marriage27 Nov 1663, Notre-Dame-De-Montréal, Montréal, Québec, Canada2
ChildrenMarie (1676-1719)
BirthLieu Indeterminé En France
Death21 Oct 1708, Pointe-Aux-Trembles, Île De Montréal, Québec, Canada
Burial21 Oct 1708, Saint-Enfant-Jésus, Pointe-Aux-Trembles, Québec, Canada3
FatherJulien Jocteau
Motherjeanne Jamais
Marriage15 Oct 1708, Saint-Enfant-Jésus, Pointe-Aux-Trembles, Québec, Canada2
Notes for Marie Faucon
17,20,2Fille du Roi, arrivée en 16633
20Marie Faucon (1644-1709)
Marie Faucon a dix-neuf ans lorsqu’elle arrive à Québec le 22 septembre 1663, probablement sur L’Aigle d’Or, avec le premier contingent des Filles du Roy. Elle est native du bourg d’Hiers (ajourd’hui Hiers-Brouage), paroisse Saint-Pierre, diocèse de Xaintes en Saintonge, également lieu de naissance de Samuel de Champlain. Elle y a été baptisée le 28 mars 1644.
Son père s’appelle Pierre et sa mère Antoinette ou Marie Berger, tous deux décédés au moment du mariage de leur fille.
Avec les sept autres Filles du Roy qui avaient choisi comme elle de venir s’installer à Montréal, Marie quitta Québec en barque ou en canot pour se rendre à Ville-Marie. Comme elle fut précédée au pays par sa cousine Jeanne Rousselière qui épousa Pierre Godin dit Châtillon, arrivé avec la Grande Recrue de 1653, elle s’installa chez elle. Est-ce sa cousine Jeanne qui lui présenta Guillaume Chartier dit Robert, son futur époux, arrivé lui aussi en 1653 ? Cela est fort possible.
Guillaume Chartier dit Robert était le fils de Jacques et de Marguerite Loisel, tous les deux également décédés au moment du mariage de leur fils en Nouvelle-France. Il était originaire de SaintThomas de La Flèche, au pays de la Loire. On ne connaît pas avec exactitude l’année de sa naissance car il a déclaré différentes dates 25 aux recensements. On rapporte qu’il a 51 ans en 1666, 25 ans en 1667 et 43 ans en 1681.
Après avoir été quelques années au service des Sulpiciens et de Maisonneuve, Guillaume obtient de ce dernier, en 1662, une terre de 10 arpents à la contrée Saint-Joseph, là où est située aujourd’hui la place Ville-Marie. Il commence à défricher sa terre en vue de s’y établir et être prêt à accueillir la femme qui l’épousera pour ensemble fonder une famille.
Deux mois après son arrivée en Nouvelle-France, Marie passe un contrat de mariage avec Guillaume le 18 novembre 1663 devant le notaire Bénigne Basset dit Deslauriers et plusieurs témoins : C. des Muceaux, Pierre Gaudin, R. Langevin, Charles Martin (époux de Catherine Dupuis, Fille du Roy), L. Chevalier, Catherine Legardeur, Agnès Petit de Piefon, Madeleine Mulluys-Mullois, P. Bonnefons, Perrin, Marie Frie, Jean Chevalier, Jehan Gervaise et même Charles Le Moyne.
Marie et Guillaume s’épousent à la paroisse Notre-Dame de Montréal le 26 novembre 1663. Les témoins sont Louis Chevalier, recrue lui aussi de 1653, et le soldat Jean Daluseau Lagarenne. Le couple s’installe à la contrée Saint-Joseph. C’est dans ce paysage que Marie, à 20 ans, donne naissance à son premier enfant, une fille, Marie Jacqueline, le 24 novembre 1664. Par bonheur, l’abbé Souart ajoute à leur concession, en janvier 1666, quatre beaux arpents déjà en valeur, vers la montagne. Au recensement de la même année, la petite Jacqueline a déjà deux ans et Guillaume avoue être tailleur et habitant. Naît alors un garçon, le 22 octobre 1666, Pierre. Les parents ont invité Pierre Caillé, un tailleur d’habits, et Étiennette Alton Hanneton, une Fille du Roy, à être ses parrain et marraine. Peut-être que le métier commun de Pierre Caillé et de Guillaume y fut pour quelque chose dans l’invitation.
Tout semble bien aller. Pourquoi alors déménager ? Pourtant, ils se départissent de leur terre à la contrée Saint-Joseph pour la somme de 400 livres et, en août 1668, en achètent une autre de 60 arpents, plus à l’ouest, en dessous du Bois-Brûlé, sans doute non défrichée, pour la somme de 70 livres.
Les Chartier-Faucon n’ont pas peur de la besogne… ni des grosses familles. Dans ces nouvelles conditions, trois autres enfants s’ajoutent aux deux premiers. Marie Madeleine, le 10 janvier 1669. Claude, le 17 novembre 1671. Et Laurent, le 17 juillet 1673. On peut dire que le couple est très actif sur le marché des terres, en plus de pourvoir aux besoins de leur progéniture. En 1674, ils revendent leur terre pour la somme de 200 livres et en achètent une autre à la côte SainteAnne, dans la paroisse naissante de la Pointe-aux-Trembles. Ils figurent d’ailleurs parmi les premières familles à s’y installer. Et ils y élèveront les six autres enfants qui naîtront. Quatre filles et deux garçons. Marie le 23 février 1676, Catherine le 17 janvier 1678, Robert le 13 décembre 1679, Elizabeth Isabelle le 13 août 1683, Marie Anne le 1 er janvier 1686 et Etienne le 3 juin 1688. Tous ont survécu.
À travers ces dernières années ponctuées de naissance répétées où la famille s’élargit, l’année 1681 et les suivantes donneront l’occasion à Marie de souffler un peu. Son mari fait engager son grand Pierre âgé de quinze ans pour un an moyennant 9 minots de blé, sa nourriture et son logement. Le 26 novembre 1681, la maison se déleste d’un autre membre lors du mariage de Marie Jacqueline avec Jacques Styve. Plus tard, Guillaume engage sa fille Madeleine, âgée de douze ans, comme domestique chez Abraham Bouat, aubergiste et marchand de Pointe-aux-Trembles, au salaire annuel de 40 livres. Et le 15 novembre 1688, Marie Madeleine créera un autre vide en se mariant à son tour avec Pierre Sanscartier Faille.
Le plus grand vide, et le plus tragique, fut laissé par la mort de Laurent, le troisième grand garçon de la famille. Il est tué par les Iroquois à l’âge de 17 ans dans une bataille à Repentigny. Les Iroquois ne se bornent pas au massacre de Lachine en 1689. Durant les années 1690 et 1691, ils sèment la terreur dans l’est de l’île. En juillet 1690, ils attaquent les habitants de Pointe-aux-Trembles à la coulée Grou, tuent dix hommes et en font cinq prisonniers. De même à Lachenaie et à Verchères. « Au printemps 1691 François Le Moyne de Bienville, le cinquième fils de Charles Le Moyne, partit pourchasser les Iroquois qui avaient ravagé la région de Montréal depuis deux ans. Avec Philippe de Rigaud de Vaudreuil et cent volontaires, il partit au début de juin 1691 à la poursuite d’une bande d’Onneiouts qui rôdait dans les alentours de l’est de Montréal. Il les attaqua à Repentigny la nuit du 6 au 7 juin. Durant cet engagement, François de Bienville fut tué, avec sept autres confrères. » Laurent, le troisième fils de Marie Faucon, figurait parmi ces sept tués. Ils sont tous mentionnés dans l’acte de décès de Laurent, inhumé le 8 juin 1691. Reste alors à la maison six enfants, la plus âgée a quinze ans et le benjamin Étienne, trois ans.
Guillaume Chartier et Marie ne finiront pas leurs jours sur leur fermette. Le 4 mars 1693, les seigneurs de Montréal concèdent à la famille un emplacement de trente-cinq pieds au village de Pointeaux-Trembles sur le niveau de la rue du cimetière. Guillaume décédera le premier à l’âge de soixante-dix ans. Il est inhumé le 23 mai 1707 dans le cimetière près de chez lui. Une rue porte d’ailleurs aujourd’hui le nom de Guillaume-Chartier à Pointe-auxTrembles. Il aura pu assister de son vivant, accompagné de sa femme Marie, au mariage de quatre de ses six enfants demeurant encore à la maison, tous mariés dans la paroisse de Pointe-aux-Trembles : Marie en 1697, Catherine en 1698, Élisabeth Isabelle en 1703 et Robert en 1706. Étienne, le dernier, se mariera après la mort de ses parents en 1712. Leur fils Claude, à trente-six ans, quelques semaines après la mort de son père, le 13 juin 1707 part pour l’Ouest, fort probablement vers les Illinois à Michillimakinac, en faisant don de ses biens, en cas de mort, à ses sœurs et à sa mère.
Marie se remarie le 15 octobre 1708, un an et demi après la mort de Guillaume, avec François Jocteau, fils de Julien et de Jeanne Jamais (Jamet). Le pauvre, il mourra six jours plus tard et sera inhumé à Pointe-aux-Trembles le 21 du mois, son acte de sépulture succédant à l’acte de mariage dans les registres de la paroisse de l’Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles. Marie Faucon ira rejoindre Guillaume, le père de ses enfants, un an plus tard, le 4 décembre 1709 à l’âge de 65 ans et sera inhumée à Pointe-aux-Trembles.
Marie Faucon a donné naissance à onze enfants. Elle les a tous « réchappés ». Les huit qui se sont mariés ont eu soixante-trois petits-enfants. Trente d’entre eux se sont mariés à leur tour, la plupart à Pointe-aux-Trembles. La Fille du Roy Marie Faucon a donc enrichi la pointe est de l’île de Montréal de tout ce petit monde humain nécessaire à peupler un pays pour en faire « quelque chose comme un grand peuple».
Descendance
1. Marie Jacqueline Chartier s’est mariée avec Jacques Styve le 26 novembre 1681 à Pointe-aux-Trembles. Ils eurent seize enfants, dont cinq se sont mariés :
Jacques Styve à Marguerite Hébert Larose à Montréal, le 23 février 1718.
Joseph Styve à Marie Hébert Larose à Montréal, le 12 janvier 1716. Marie Styve à Pierre Lamothe à Montréal, le 23 novembre 1715. Marie Cécile Jeanne Styve à Jean Baptiste Halle, à Montréal le 16 février 1733.
Marie Anne Styve à Antoine Desrosiers Dutremble, à Montréal le 22 mai 1725.
2. Pierre Chartier s’est marié avec Catherine Cantin à Montréal, le 27 novembre 1717.
Ils n’ont pas eu d’enfant.
3. Marie Madeleine Chartier s’est mariée avec Pierre Sanscartier Faille à Pointe-aux-Trembles, le 15 novembre 1688. Ils eurent trois enfants, dont deux se sont mariés :
Marie Anne Sanscartier Faille à François Lamontagne Badayac Banliac à Trois-Rivières, le 12 janvier 1712.
Marie Madeleine Sanscartier Faille à Pierre Chonar Lagiroflee à Pointe-aux-Trembles, le 4 décembre 1708.
4. Marie Chartier s’est mariée avec Bernard Brouillet Laviolette à Pointe-aux-Trembles, le 28 juin 1697. Ils eurent quatorze enfants, dont huit se sont mariés.
Jean Baptiste Brouillet Laviolette à Marie Thérèse Lorion à Pointe-aux-Trembles, le 5 novembre 1731.
Marie Catherine Brouillet Laviolette à André Janot Lachapelle à Pointe-aux-Trembles, le 15 décembre 1723.
Robert Brouillet Laviolette à Marie Catherine Lorion à Pointeaux-Trembles, le 10 février 1738.
Marie Catherine Brouillet Laviolette à Charles Goguet à Pointeaux-Trembles, le 19 avril 1723.
Élisabeth Isabelle Brouillet Laviolette à André Beaudin Sansremission, à Pointe-aux-Trembles le 14 janvier 1737.
Marie Anne Brouillet Laviolette à Jean Baptiste Renaud Blanchard à Pointe-aux-Trembles, le 17 février 1738.
Michel Brouillet Laviolette à Marie Louise Renaudet à Chambly, le 6 juin 1735.
Marie Josephe Brouillet Laviolette à Louis Lorion à Montréal, le 12 novembre 1742.
5. Catherine Chartier s’est mariée avec Jean Baptiste Choinière Sabourin à Pointe-aux-Trembles, le 10 juin 1698. Ils eurent un seul enfant, qui est mort moins d’un mois après sa naissance.
6. Robert Chartier s’est marié avec Marie Anne Demers Dumais à Pointe-aux-Trembles le 15 novembre 1706. Ils eurent douze enfants, dont sept se sont mariés.
François Chartier à Marie Hélene Larcheveque à Saint-Françoisd’Assise-de-Longue-Pointe, le 17 avril 1741.
Marie Anne Chartier à Laurent Janot Lachapelle à Pointe-auxTrembles, le 29 janvier 1731.
Marie Angélique Chartier à Jacques Beique Lafleur à Pointe aux-Trembles, le 9 février 1739.
Louis Chartier à Marie Josephe Allard Longpré à Saint-Françoisd’Assise-de-Longue-Pointe, le 12 janvier 1750.
Catherine Chartier à Louis Blais à Pointe-aux-Trembles, le 20 novembre 1747.
Marie Josèphe Chartier à Joseph Bazinet à Pointe-aux-Trembles, le 27 novembre 1740.
Dominique Chartier à Marie Anne Allard Longpré à SaintFrançois-d’Assise-de-Longue-Pointe, le 12 janvier 1750.
7. Élisabeth Isabelle Chartier s’est mariée avec Jean Petit à Pointeaux-Trembles, le 23 janvier 1703. Ils eurent quatre enfants, dont deux se sont mariés.
Jean Baptiste Petit à Marie Claire Caty à Pointe-aux-Trembles, le 10 janvier 1735.
Louis Petit à Marie Angélique Simon Léonard à Pointe-auxTrembles, le 8 janvier 1731.
8. Étienne Chartier s’est marié avec Jeanne Drapeau Laforge à Rivière-des-Prairies, le 6 février 1712. Ils eurent treize enfants, dont six se sont mariés.
Thérèse Chartier à Jacques Fonteneau Dumoulin Moulin à Pointe-aux-Trembles, le 15 janvier 1731.
Marie Josephe Chartier à Antoine Daunais Lafrenière à Pointeaux-Trembles, le 25 mai 1735.
Joseph Chartier à Marie Josephe Bricault Lamarche à Pointeaux-Trembles, le 30 janvier 1741.
Charles Chartier à Marie Catherine Chodillon à Pointe-auxTrembles, le 25 janvier 1751.
Jean Baptiste Chartier à Marie Françoise Bombardier Labombarde à Pointe-aux-Trembles, le 9 janvier 1747.
Marie Élisabeth Isabelle à François Bazinet à Pointe-auxTrembles, le 11 janvier 1745.
Sylvie Lachapelle et Yves Chevrier20
20Marie Faucon (1644-1709)
Marie Faucon a dix-neuf ans lorsqu’elle arrive à Québec le 22 septembre 1663, probablement sur L’Aigle d’Or, avec le premier contingent des Filles du Roy. Elle est native du bourg d’Hiers (ajourd’hui Hiers-Brouage), paroisse Saint-Pierre, diocèse de Xaintes en Saintonge, également lieu de naissance de Samuel de Champlain. Elle y a été baptisée le 28 mars 1644.
Son père s’appelle Pierre et sa mère Antoinette ou Marie Berger, tous deux décédés au moment du mariage de leur fille.
Avec les sept autres Filles du Roy qui avaient choisi comme elle de venir s’installer à Montréal, Marie quitta Québec en barque ou en canot pour se rendre à Ville-Marie. Comme elle fut précédée au pays par sa cousine Jeanne Rousselière qui épousa Pierre Godin dit Châtillon, arrivé avec la Grande Recrue de 1653, elle s’installa chez elle. Est-ce sa cousine Jeanne qui lui présenta Guillaume Chartier dit Robert, son futur époux, arrivé lui aussi en 1653 ? Cela est fort possible.
Guillaume Chartier dit Robert était le fils de Jacques et de Marguerite Loisel, tous les deux également décédés au moment du mariage de leur fils en Nouvelle-France. Il était originaire de SaintThomas de La Flèche, au pays de la Loire. On ne connaît pas avec exactitude l’année de sa naissance car il a déclaré différentes dates 25 aux recensements. On rapporte qu’il a 51 ans en 1666, 25 ans en 1667 et 43 ans en 1681.
Après avoir été quelques années au service des Sulpiciens et de Maisonneuve, Guillaume obtient de ce dernier, en 1662, une terre de 10 arpents à la contrée Saint-Joseph, là où est située aujourd’hui la place Ville-Marie. Il commence à défricher sa terre en vue de s’y établir et être prêt à accueillir la femme qui l’épousera pour ensemble fonder une famille.
Deux mois après son arrivée en Nouvelle-France, Marie passe un contrat de mariage avec Guillaume le 18 novembre 1663 devant le notaire Bénigne Basset dit Deslauriers et plusieurs témoins : C. des Muceaux, Pierre Gaudin, R. Langevin, Charles Martin (époux de Catherine Dupuis, Fille du Roy), L. Chevalier, Catherine Legardeur, Agnès Petit de Piefon, Madeleine Mulluys-Mullois, P. Bonnefons, Perrin, Marie Frie, Jean Chevalier, Jehan Gervaise et même Charles Le Moyne.
Marie et Guillaume s’épousent à la paroisse Notre-Dame de Montréal le 26 novembre 1663. Les témoins sont Louis Chevalier, recrue lui aussi de 1653, et le soldat Jean Daluseau Lagarenne. Le couple s’installe à la contrée Saint-Joseph. C’est dans ce paysage que Marie, à 20 ans, donne naissance à son premier enfant, une fille, Marie Jacqueline, le 24 novembre 1664. Par bonheur, l’abbé Souart ajoute à leur concession, en janvier 1666, quatre beaux arpents déjà en valeur, vers la montagne. Au recensement de la même année, la petite Jacqueline a déjà deux ans et Guillaume avoue être tailleur et habitant. Naît alors un garçon, le 22 octobre 1666, Pierre. Les parents ont invité Pierre Caillé, un tailleur d’habits, et Étiennette Alton Hanneton, une Fille du Roy, à être ses parrain et marraine. Peut-être que le métier commun de Pierre Caillé et de Guillaume y fut pour quelque chose dans l’invitation.
Tout semble bien aller. Pourquoi alors déménager ? Pourtant, ils se départissent de leur terre à la contrée Saint-Joseph pour la somme de 400 livres et, en août 1668, en achètent une autre de 60 arpents, plus à l’ouest, en dessous du Bois-Brûlé, sans doute non défrichée, pour la somme de 70 livres.
Les Chartier-Faucon n’ont pas peur de la besogne… ni des grosses familles. Dans ces nouvelles conditions, trois autres enfants s’ajoutent aux deux premiers. Marie Madeleine, le 10 janvier 1669. Claude, le 17 novembre 1671. Et Laurent, le 17 juillet 1673. On peut dire que le couple est très actif sur le marché des terres, en plus de pourvoir aux besoins de leur progéniture. En 1674, ils revendent leur terre pour la somme de 200 livres et en achètent une autre à la côte SainteAnne, dans la paroisse naissante de la Pointe-aux-Trembles. Ils figurent d’ailleurs parmi les premières familles à s’y installer. Et ils y élèveront les six autres enfants qui naîtront. Quatre filles et deux garçons. Marie le 23 février 1676, Catherine le 17 janvier 1678, Robert le 13 décembre 1679, Elizabeth Isabelle le 13 août 1683, Marie Anne le 1 er janvier 1686 et Etienne le 3 juin 1688. Tous ont survécu.
À travers ces dernières années ponctuées de naissance répétées où la famille s’élargit, l’année 1681 et les suivantes donneront l’occasion à Marie de souffler un peu. Son mari fait engager son grand Pierre âgé de quinze ans pour un an moyennant 9 minots de blé, sa nourriture et son logement. Le 26 novembre 1681, la maison se déleste d’un autre membre lors du mariage de Marie Jacqueline avec Jacques Styve. Plus tard, Guillaume engage sa fille Madeleine, âgée de douze ans, comme domestique chez Abraham Bouat, aubergiste et marchand de Pointe-aux-Trembles, au salaire annuel de 40 livres. Et le 15 novembre 1688, Marie Madeleine créera un autre vide en se mariant à son tour avec Pierre Sanscartier Faille.
Le plus grand vide, et le plus tragique, fut laissé par la mort de Laurent, le troisième grand garçon de la famille. Il est tué par les Iroquois à l’âge de 17 ans dans une bataille à Repentigny. Les Iroquois ne se bornent pas au massacre de Lachine en 1689. Durant les années 1690 et 1691, ils sèment la terreur dans l’est de l’île. En juillet 1690, ils attaquent les habitants de Pointe-aux-Trembles à la coulée Grou, tuent dix hommes et en font cinq prisonniers. De même à Lachenaie et à Verchères. « Au printemps 1691 François Le Moyne de Bienville, le cinquième fils de Charles Le Moyne, partit pourchasser les Iroquois qui avaient ravagé la région de Montréal depuis deux ans. Avec Philippe de Rigaud de Vaudreuil et cent volontaires, il partit au début de juin 1691 à la poursuite d’une bande d’Onneiouts qui rôdait dans les alentours de l’est de Montréal. Il les attaqua à Repentigny la nuit du 6 au 7 juin. Durant cet engagement, François de Bienville fut tué, avec sept autres confrères. » Laurent, le troisième fils de Marie Faucon, figurait parmi ces sept tués. Ils sont tous mentionnés dans l’acte de décès de Laurent, inhumé le 8 juin 1691. Reste alors à la maison six enfants, la plus âgée a quinze ans et le benjamin Étienne, trois ans.
Guillaume Chartier et Marie ne finiront pas leurs jours sur leur fermette. Le 4 mars 1693, les seigneurs de Montréal concèdent à la famille un emplacement de trente-cinq pieds au village de Pointeaux-Trembles sur le niveau de la rue du cimetière. Guillaume décédera le premier à l’âge de soixante-dix ans. Il est inhumé le 23 mai 1707 dans le cimetière près de chez lui. Une rue porte d’ailleurs aujourd’hui le nom de Guillaume-Chartier à Pointe-auxTrembles. Il aura pu assister de son vivant, accompagné de sa femme Marie, au mariage de quatre de ses six enfants demeurant encore à la maison, tous mariés dans la paroisse de Pointe-aux-Trembles : Marie en 1697, Catherine en 1698, Élisabeth Isabelle en 1703 et Robert en 1706. Étienne, le dernier, se mariera après la mort de ses parents en 1712. Leur fils Claude, à trente-six ans, quelques semaines après la mort de son père, le 13 juin 1707 part pour l’Ouest, fort probablement vers les Illinois à Michillimakinac, en faisant don de ses biens, en cas de mort, à ses sœurs et à sa mère.
Marie se remarie le 15 octobre 1708, un an et demi après la mort de Guillaume, avec François Jocteau, fils de Julien et de Jeanne Jamais (Jamet). Le pauvre, il mourra six jours plus tard et sera inhumé à Pointe-aux-Trembles le 21 du mois, son acte de sépulture succédant à l’acte de mariage dans les registres de la paroisse de l’Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles. Marie Faucon ira rejoindre Guillaume, le père de ses enfants, un an plus tard, le 4 décembre 1709 à l’âge de 65 ans et sera inhumée à Pointe-aux-Trembles.
Marie Faucon a donné naissance à onze enfants. Elle les a tous « réchappés ». Les huit qui se sont mariés ont eu soixante-trois petits-enfants. Trente d’entre eux se sont mariés à leur tour, la plupart à Pointe-aux-Trembles. La Fille du Roy Marie Faucon a donc enrichi la pointe est de l’île de Montréal de tout ce petit monde humain nécessaire à peupler un pays pour en faire « quelque chose comme un grand peuple».
Descendance
1. Marie Jacqueline Chartier s’est mariée avec Jacques Styve le 26 novembre 1681 à Pointe-aux-Trembles. Ils eurent seize enfants, dont cinq se sont mariés :
Jacques Styve à Marguerite Hébert Larose à Montréal, le 23 février 1718.
Joseph Styve à Marie Hébert Larose à Montréal, le 12 janvier 1716. Marie Styve à Pierre Lamothe à Montréal, le 23 novembre 1715. Marie Cécile Jeanne Styve à Jean Baptiste Halle, à Montréal le 16 février 1733.
Marie Anne Styve à Antoine Desrosiers Dutremble, à Montréal le 22 mai 1725.
2. Pierre Chartier s’est marié avec Catherine Cantin à Montréal, le 27 novembre 1717.
Ils n’ont pas eu d’enfant.
3. Marie Madeleine Chartier s’est mariée avec Pierre Sanscartier Faille à Pointe-aux-Trembles, le 15 novembre 1688. Ils eurent trois enfants, dont deux se sont mariés :
Marie Anne Sanscartier Faille à François Lamontagne Badayac Banliac à Trois-Rivières, le 12 janvier 1712.
Marie Madeleine Sanscartier Faille à Pierre Chonar Lagiroflee à Pointe-aux-Trembles, le 4 décembre 1708.
4. Marie Chartier s’est mariée avec Bernard Brouillet Laviolette à Pointe-aux-Trembles, le 28 juin 1697. Ils eurent quatorze enfants, dont huit se sont mariés.
Jean Baptiste Brouillet Laviolette à Marie Thérèse Lorion à Pointe-aux-Trembles, le 5 novembre 1731.
Marie Catherine Brouillet Laviolette à André Janot Lachapelle à Pointe-aux-Trembles, le 15 décembre 1723.
Robert Brouillet Laviolette à Marie Catherine Lorion à Pointeaux-Trembles, le 10 février 1738.
Marie Catherine Brouillet Laviolette à Charles Goguet à Pointeaux-Trembles, le 19 avril 1723.
Élisabeth Isabelle Brouillet Laviolette à André Beaudin Sansremission, à Pointe-aux-Trembles le 14 janvier 1737.
Marie Anne Brouillet Laviolette à Jean Baptiste Renaud Blanchard à Pointe-aux-Trembles, le 17 février 1738.
Michel Brouillet Laviolette à Marie Louise Renaudet à Chambly, le 6 juin 1735.
Marie Josephe Brouillet Laviolette à Louis Lorion à Montréal, le 12 novembre 1742.
5. Catherine Chartier s’est mariée avec Jean Baptiste Choinière Sabourin à Pointe-aux-Trembles, le 10 juin 1698. Ils eurent un seul enfant, qui est mort moins d’un mois après sa naissance.
6. Robert Chartier s’est marié avec Marie Anne Demers Dumais à Pointe-aux-Trembles le 15 novembre 1706. Ils eurent douze enfants, dont sept se sont mariés.
François Chartier à Marie Hélene Larcheveque à Saint-Françoisd’Assise-de-Longue-Pointe, le 17 avril 1741.
Marie Anne Chartier à Laurent Janot Lachapelle à Pointe-auxTrembles, le 29 janvier 1731.
Marie Angélique Chartier à Jacques Beique Lafleur à Pointe aux-Trembles, le 9 février 1739.
Louis Chartier à Marie Josephe Allard Longpré à Saint-Françoisd’Assise-de-Longue-Pointe, le 12 janvier 1750.
Catherine Chartier à Louis Blais à Pointe-aux-Trembles, le 20 novembre 1747.
Marie Josèphe Chartier à Joseph Bazinet à Pointe-aux-Trembles, le 27 novembre 1740.
Dominique Chartier à Marie Anne Allard Longpré à SaintFrançois-d’Assise-de-Longue-Pointe, le 12 janvier 1750.
7. Élisabeth Isabelle Chartier s’est mariée avec Jean Petit à Pointeaux-Trembles, le 23 janvier 1703. Ils eurent quatre enfants, dont deux se sont mariés.
Jean Baptiste Petit à Marie Claire Caty à Pointe-aux-Trembles, le 10 janvier 1735.
Louis Petit à Marie Angélique Simon Léonard à Pointe-auxTrembles, le 8 janvier 1731.
8. Étienne Chartier s’est marié avec Jeanne Drapeau Laforge à Rivière-des-Prairies, le 6 février 1712. Ils eurent treize enfants, dont six se sont mariés.
Thérèse Chartier à Jacques Fonteneau Dumoulin Moulin à Pointe-aux-Trembles, le 15 janvier 1731.
Marie Josephe Chartier à Antoine Daunais Lafrenière à Pointeaux-Trembles, le 25 mai 1735.
Joseph Chartier à Marie Josephe Bricault Lamarche à Pointeaux-Trembles, le 30 janvier 1741.
Charles Chartier à Marie Catherine Chodillon à Pointe-auxTrembles, le 25 janvier 1751.
Jean Baptiste Chartier à Marie Françoise Bombardier Labombarde à Pointe-aux-Trembles, le 9 janvier 1747.
Marie Élisabeth Isabelle à François Bazinet à Pointe-auxTrembles, le 11 janvier 1745.
Sylvie Lachapelle et Yves Chevrier20
Notes for Guillaume (Spouse 1)
9Fait parti de La Grande Recrue de 1653
9CHARTIER dit ROBERT, Guillaume, fut un humble mais généreux et persévérant membre de la recrue de 1653, arrivée à Montréal avec M. de Maisonneuve et Mlle (plus tard Soeur, et aujourd'hui bienheureuse) Marguerite Bourgeoys : modeste mais solide pierre jetée dans les fondations des débuts héroiques de Ville-Marie. Il avait alors 18 ans, étant né en 1635 (Tanguay, I, 120 et III, 27; recens., 1666 (celui de 1667 ne lui donne que 25 ans, et celui de 1681, que 43 ans ce qui semble bien jeune), dans la province d'Anjou (Sarthe), ville de La Flèche où régnait alors une intense atmosphère de vie mystique et missionnaire qui fournit toute la recrue de 1653 moins une quarantaine de membres, dans la paroisse de Saint-Tho-mas, l'unique paroisse de cette ville et paroisse de Jérôme Le Royer de la Dauversière (Dict. Universel de la France ancienne et moderne, Paris, 1726, au mot Flèche (La). Guillaume Chartier était le fils de Jacques et de Marguerite Loisel.
Il passait son contrat d'engagement pour Villemarie le 20
avril 1653 (gr. Lafousse) et son acquit de 123 livres est du 20 juin suivant (gr. Belliotte) cité par Faillon (Hist., II, p. 537).
Chartier était tailleur
d'habits en France et son contrat, comme la plupart des autres engagés, était pour cinq ans (Soeur Mondoux, RHAF II, p. 69). Au terme de son con-trat, notre homme préféra s'attacher au Canada plutôt que de retourner, même gratuitement, en France.
Le 20 août 1662, il reçut de M. de Mai-
sonneuve une concession de six arpents "à la contrée St-Joseph" (à l'ouest du carré Chaboillez et de la gare Windsor aujourd'hui) à laquelle s'ajouta une concession de quatre arpents, vers la montagne, faite par M. Souart, curé et supérieur des Sulpiciens, alors seigneurs de l'île de Montréal, le 5 février 1667 (BRH 1927, p. 224; 1928, p. 462).
Le 27 novembre 1663,
Guillaume Chartier unissait sa destinée à celle de Maria Faulcon (et Fau-con), 19 ans, fille de Pierre et de Marie Berger. La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans la chapelle Notre-Dame de l'Hôtel-Dieu, alors église paroissiale temporaire de Villemarie. Le contrat de mariage fut reçu par le notaire Basset le 18 novembre précédent en présence de Jean Gervaise, Charles LeMoyne, Charles d'Ailleboust des Musseaux, et Pierre Gaudin dit Châtillon.
Le 2 octobre 1667, Guillaume Chartier consent une vente à Marin Hurtubise (voir pièce 13) qu'il acquitte le 29 juillet 1668 (gr. Basset).
D'autre part, notre colon achète une terre de Mathurin Goyer dit Laviolette le 10 août 1668, terre qu'il vend ensuite à Jean Dutartre dit Desrosiers le 30 décembre 1674 (gr. Basset).
C'est à cette date, croyons-nous, qu'il
faille fixer le départ de Guillaume Chartier et des siens pour la Pointe-aux-Trembles de Montréal, où sont baptisés ses autres enfants, cinq l'ayant été à Montréal. C'est là que le trouve le recensement de 1681 avec six arpents de terre en valeur, et cela, nonobstant l'indication assez imprécise du ter-rier* seigneurial (no 1280, no 74 du cadastre de 1861) qui dit que notre colon y fut concessionnaire "de deux arpents sur vingt vers l'an 1684 et dont nous n'avons pas le contrat dans nos archives mais seulement titre nouvel de la ditte terre avec plus grande profondeur savoir de deux arpents sur quarante en faveur de G. Brouillet dit Laviolette en date du dix may 1698 et qui doibt par an dix sols demi pour vingt arpents sur la reduction' Le recensement de 1681 donne assez bien l'idée du développement de la famille de Guillaume Chartier : Guillaume Chartier, tailleur, 43, (ans) :
Marie Faucon, sa femme 36; enfants : Jacqueline 17, Pierre 16, Madeleine 14, Claude 12, Laurent 10, Marie 7, Catherine 4, Robert 2; un fusil, une
Après 1681,
Etienne (ce dernier, né en 1688, survivra de beaucoup à tous ses frères et soeurs car il ne sera inhumé qu'en 1777), ce qui fait un total de onze enfants en tout.
Guillaume Chartier se faisait donner une concession par les
seigneurs de la Pointe-aux-Trembles le 4 mars 1693, et il consentait une vente à Gilles Brouillet le 18 juin 1697, qu'il acquittait le 16 novembre 1698 (gr. Adhémar). C'est un des derniers actes notariés relatifs à ce brave ancêtre qui eut la douleur de perdre son fils Laurent, tué aux côtés de LeMoyne de Bienville le 6 juin 1691 (Histoire de la Congrégation Notre-Dame, vol. II, page 398) , au cours d'une poursuite contre un parti d'Iroquois à la côte de Repentigny.
Une de ses filles, devenue veuve, se fit reli-
gieuse dans la Congrégation Notre-Dame sous le nom de Soeur Ste-Margue-rite, devenant ainsi la première vocation de la postérité de Guillaume Char-tier.
Ce dernier s'éteignit en 1707, âgé de près de 78 ans dit l'acte du 23 mai, alors qu'en réalité il pouvait en avoir 72. Son épouse lui survécut à peine un an et demi ce qui ne l'empêcha pas de convoler le 15 octobre 1708 avec François Jocteau qu'elle eut la douleur de perdre huit jours plus tard.
Marie Faucon mourut à 68 ans, et elle fut inhumée le 15 novembre 1709.
Faisons donc l'éloge des hommes illustres et des pères de notre race (ECCL.
44, 1). Nombreuse descendance sous les noms de Chartier et de Robert.
Père J.-M. Chartier-Robert, c.s.v.
9CHARTIER dit ROBERT, Guillaume, fut un humble mais généreux et persévérant membre de la recrue de 1653, arrivée à Montréal avec M. de Maisonneuve et Mlle (plus tard Soeur, et aujourd'hui bienheureuse) Marguerite Bourgeoys : modeste mais solide pierre jetée dans les fondations des débuts héroiques de Ville-Marie. Il avait alors 18 ans, étant né en 1635 (Tanguay, I, 120 et III, 27; recens., 1666 (celui de 1667 ne lui donne que 25 ans, et celui de 1681, que 43 ans ce qui semble bien jeune), dans la province d'Anjou (Sarthe), ville de La Flèche où régnait alors une intense atmosphère de vie mystique et missionnaire qui fournit toute la recrue de 1653 moins une quarantaine de membres, dans la paroisse de Saint-Tho-mas, l'unique paroisse de cette ville et paroisse de Jérôme Le Royer de la Dauversière (Dict. Universel de la France ancienne et moderne, Paris, 1726, au mot Flèche (La). Guillaume Chartier était le fils de Jacques et de Marguerite Loisel.
Il passait son contrat d'engagement pour Villemarie le 20
avril 1653 (gr. Lafousse) et son acquit de 123 livres est du 20 juin suivant (gr. Belliotte) cité par Faillon (Hist., II, p. 537).
Chartier était tailleur
d'habits en France et son contrat, comme la plupart des autres engagés, était pour cinq ans (Soeur Mondoux, RHAF II, p. 69). Au terme de son con-trat, notre homme préféra s'attacher au Canada plutôt que de retourner, même gratuitement, en France.
Le 20 août 1662, il reçut de M. de Mai-
sonneuve une concession de six arpents "à la contrée St-Joseph" (à l'ouest du carré Chaboillez et de la gare Windsor aujourd'hui) à laquelle s'ajouta une concession de quatre arpents, vers la montagne, faite par M. Souart, curé et supérieur des Sulpiciens, alors seigneurs de l'île de Montréal, le 5 février 1667 (BRH 1927, p. 224; 1928, p. 462).
Le 27 novembre 1663,
Guillaume Chartier unissait sa destinée à celle de Maria Faulcon (et Fau-con), 19 ans, fille de Pierre et de Marie Berger. La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans la chapelle Notre-Dame de l'Hôtel-Dieu, alors église paroissiale temporaire de Villemarie. Le contrat de mariage fut reçu par le notaire Basset le 18 novembre précédent en présence de Jean Gervaise, Charles LeMoyne, Charles d'Ailleboust des Musseaux, et Pierre Gaudin dit Châtillon.
Le 2 octobre 1667, Guillaume Chartier consent une vente à Marin Hurtubise (voir pièce 13) qu'il acquitte le 29 juillet 1668 (gr. Basset).
D'autre part, notre colon achète une terre de Mathurin Goyer dit Laviolette le 10 août 1668, terre qu'il vend ensuite à Jean Dutartre dit Desrosiers le 30 décembre 1674 (gr. Basset).
C'est à cette date, croyons-nous, qu'il
faille fixer le départ de Guillaume Chartier et des siens pour la Pointe-aux-Trembles de Montréal, où sont baptisés ses autres enfants, cinq l'ayant été à Montréal. C'est là que le trouve le recensement de 1681 avec six arpents de terre en valeur, et cela, nonobstant l'indication assez imprécise du ter-rier* seigneurial (no 1280, no 74 du cadastre de 1861) qui dit que notre colon y fut concessionnaire "de deux arpents sur vingt vers l'an 1684 et dont nous n'avons pas le contrat dans nos archives mais seulement titre nouvel de la ditte terre avec plus grande profondeur savoir de deux arpents sur quarante en faveur de G. Brouillet dit Laviolette en date du dix may 1698 et qui doibt par an dix sols demi pour vingt arpents sur la reduction' Le recensement de 1681 donne assez bien l'idée du développement de la famille de Guillaume Chartier : Guillaume Chartier, tailleur, 43, (ans) :
Marie Faucon, sa femme 36; enfants : Jacqueline 17, Pierre 16, Madeleine 14, Claude 12, Laurent 10, Marie 7, Catherine 4, Robert 2; un fusil, une
Après 1681,
Etienne (ce dernier, né en 1688, survivra de beaucoup à tous ses frères et soeurs car il ne sera inhumé qu'en 1777), ce qui fait un total de onze enfants en tout.
Guillaume Chartier se faisait donner une concession par les
seigneurs de la Pointe-aux-Trembles le 4 mars 1693, et il consentait une vente à Gilles Brouillet le 18 juin 1697, qu'il acquittait le 16 novembre 1698 (gr. Adhémar). C'est un des derniers actes notariés relatifs à ce brave ancêtre qui eut la douleur de perdre son fils Laurent, tué aux côtés de LeMoyne de Bienville le 6 juin 1691 (Histoire de la Congrégation Notre-Dame, vol. II, page 398) , au cours d'une poursuite contre un parti d'Iroquois à la côte de Repentigny.
Une de ses filles, devenue veuve, se fit reli-
gieuse dans la Congrégation Notre-Dame sous le nom de Soeur Ste-Margue-rite, devenant ainsi la première vocation de la postérité de Guillaume Char-tier.
Ce dernier s'éteignit en 1707, âgé de près de 78 ans dit l'acte du 23 mai, alors qu'en réalité il pouvait en avoir 72. Son épouse lui survécut à peine un an et demi ce qui ne l'empêcha pas de convoler le 15 octobre 1708 avec François Jocteau qu'elle eut la douleur de perdre huit jours plus tard.
Marie Faucon mourut à 68 ans, et elle fut inhumée le 15 novembre 1709.
Faisons donc l'éloge des hommes illustres et des pères de notre race (ECCL.
44, 1). Nombreuse descendance sous les noms de Chartier et de Robert.
Père J.-M. Chartier-Robert, c.s.v.
Notes for Guillaume & Marie (Family)
11 enfants de cette union3
Notes for François & Marie (Family)
Aucun enfant3