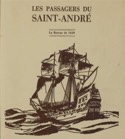Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Birth1 Jul 1650, Montréal, Québec, Canada
Death22 Dec 1727, Montréal, Québec, Canada
FatherLéonard Lucos dit Barbeau (1626-1651)
MotherBarbe Poisson (~1633-1711)
Spouses
Birth30 Dec 1637, Mareil-sur-Loire, France
Deathabt 1712
FlagsBiography, Iroquois, La Recrue de 1659, Ship Saint-André
Marriage13 Ab 1665, Montréal, Québec, Canada
Notes for Marie Lucos dit Barbeau
Le parrain de Marie était le Sieur de Maisonneuve, La maraine, Adrienne de Vivier, épouse de Robert Cavalier de Lasalle. Au déces de René, Marie s'est remariée 5 mois plus tard à Gabriel Celles dit Duclos.
Marie était née à Montréal le 1er juillet 1650 et fut baptisée le même jour par le père André Richard. Ses parrain et marraine étaient Paul Chomédey, gouverneur, et Adrienne Divivier. Elle fut inhumée à Montréal le 22 décembre 1727. Étaient présents: les pères Mathis et Falcoz. Le père F. Cheze officiait
Marie était née à Montréal le 1er juillet 1650 et fut baptisée le même jour par le père André Richard. Ses parrain et marraine étaient Paul Chomédey, gouverneur, et Adrienne Divivier. Elle fut inhumée à Montréal le 22 décembre 1727. Étaient présents: les pères Mathis et Falcoz. Le père F. Cheze officiait
Notes for René (Spouse 1)
11Recrue de 1659
11Cuillerier38, René, était âgé de 19 ou 20 ans quand il s’engagea le
8 juin 1659 à La Rochelle envers Soeur Judith Moreau comme serviteur à l’Hôtel-Dieu au salaire de 75 livres par année. A son mariage il se dit « de Clermont près La Flèche en Anjou » mais dans son testament il précise qu’il est natif de Verron (dont les registres ont disparu). Ce colon a connu une débordante activité ce qui lui a, apparemment, valu son surnom de « Léveillé ». Il serait téméraire de vouloir résumer la carrière d’un homme qui a laissé dans les seules minutes des notaires de Montréal 139 pièces, et nous en oublions 39. Contentons-nous de quelques traits. Deux ans après son arrivée, le 25 octobre 1661, Cuillerier faillit être tué au massacre de l’île à la Pierre où périt l’abbé Vignal et quelques autres Français. Emmené prisonnier au canton des Onnéiouts, il reçut la bastonnade et eut des ongles arrachés. On allait le brûler lorsque la soeur d’un capitaine tué au combat le demanda pour tenir la place de son frère. Dix-neuf mois s’écoulèrent. Un jour qu’il avait suivi les Onnéiouts à la chasse, il réussit à s’enfuir jusqu’à Orange, d’où il regagna Montréal. En 1665, René Cuillerier épousa Marie Lucault, dont le père Léonard Lucault avait été tué par les Iroquois. Toute la noblesse de Montréal voulut être de la noce, et Charles d’Ailleboust des Musseaux, neveu du gouverneur de ce nom, rédigea de sa main le contrat de mariage. Lorsque Lachine naquit, Cuillerier en fut l’un des notables. Sa maison fortifiée s'appela le fort Cuillerier. Durant l’hiver 1675-1676, l’abbé Guyotte, sulpicien, s’y fit bâtir une chapelle au fief Verdun (Lachine) de concert avec René Cuillerier, premier marguillier du lieu agissant au nom de la fabrique. Cultivateur et négociant, cet homme estimable atteignit à une honnête aisance. Son testament daté le 22 mars 1712 témoigne des plus purs sentiments chrétiens. Il semble avoir quitté cette terre en 1716, à 76 .ans40. Il laissait onze enfants mariés, des seize que le Ciel lui avait donnés. Les milliers de Cuillerier et Cuerrier actuels ont droit d'être fiers de leur ancêtre.
(1639-1712) CUILLERIER, RENÉ, engagé de l'Hôtel-Dieu de Montréal, colon, né probablement à Veron, diocèse d'Angers, vers 1639, fils de Julien Cuillerier et de Julienne Faifeu, décédé à Montréal vers 1712.
René Cuillerier arrive en Nouvelle-France le 7 septembre 1659. Il signe un engagement avec soeur Judith Moreau de Brésoles, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal, devant le notaire A. Demontreau à La Rochelle, le 8 juin 1659.
Par cet acte, il devient serviteur de l'hôpital de Ville-Marie à un salaire annuel de 75ª. Dès l'automne, il est à Montréal et, le 25 octobre 1661, avec quelques colons secondés de membres de la garnison et dirigés par l'abbé Guillaume Vignal, il se rend à l'île à la Pierre, dans le Saint-Laurent, pour y extraire des matériaux destinés à l'achèvement de la contruction du premier séminaire de Montréal.
Mal lui en prit, car les Iroquois, qui rôdaient dans les environs, attaquent les travailleurs, en tuent quelques-uns, en blessent d'autres et capturent Vignal, Claude de Brigeac, Cuillerier et Jacques Dufresne. Cuillerier et Brigeac sont emmenés en captivité chez les Onneiouts. Ils reçoivent la bastonnade et Cuillerier a les ongles arrachés. Les Indiens décident alors de brûler les deux Français. Brigeac est supplicié le premier, mais Cuillerier est sauvé par une Indienne qui demanda à l'adopter « afin de lui tenir la place de son frère ». Durant sa captivité qui dure 19 mois, il rencontre d'autres compagnons d'infortune : Michel Messier, dit Saint-Michel, et Urbain Tessier, dit Lavigne.
Au printemps de 1663, Cuillerier profite d'une partie de chasse avec les Onneiouts, auxquels s'étaient joints des Agniers et quelques Français captifs, pour s'enfuir vers la Nouvelle-Hollande. Il se rend au fort Orange, d'où il passe à Boston pour atteindre finalement Québec. De retour à Montréal à la fin de l'été, il reprend son service chez les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu.
Le 20 mai 1665, il s'établit sur l'île de Montréal, ayant obtenu des Sulpiciens une concession de 45 arpents. Cette terre fera partie du fief de Verdun, concédé en 1671. Il participe à la fondation de Lachine et en devient le premier marguillier en 1675. L'année suivante, sa maison fortifiée prend le nom de fort Cuillerier. Au recensement de 1681, il a 32 arpents en valeur et il possède six fusils, un pistolet et six bêtes à cornes.
Malade depuis un certain temps, Cuillerier fait son testament le 22 mars 1712 devant le curé Louis-Michel de Vilermaula de Lachine. Ses dernières volontés sont déposées dans le greffe de Jean-Baptiste Adhémar le 26 janvier 1716. Même si la date de sa mort nous est inconnue, un acte notarié du 27 janvier 1718, passé devant le notaire Adhémar et déposé dans le greffe de Michel Lepallieur, nous signale que la dame Lucault est « demeuré veufve dud Sieur son époux depuis plus de Cinq ans ».
René Cuillerier a épousé, le 13 avril 1665, dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Marie Lucault, fille de Léonard Barbeau, dit Lucault, et de Barbe Poisson. De ce mariage sont nés 16 enfants, dont 7 sont baptisés à Montréal et les autres à Lachine.
(Perrault, Claude, "Dictionnaire biographique du Canada", vol. 2)
11Cuillerier38, René, était âgé de 19 ou 20 ans quand il s’engagea le
8 juin 1659 à La Rochelle envers Soeur Judith Moreau comme serviteur à l’Hôtel-Dieu au salaire de 75 livres par année. A son mariage il se dit « de Clermont près La Flèche en Anjou » mais dans son testament il précise qu’il est natif de Verron (dont les registres ont disparu). Ce colon a connu une débordante activité ce qui lui a, apparemment, valu son surnom de « Léveillé ». Il serait téméraire de vouloir résumer la carrière d’un homme qui a laissé dans les seules minutes des notaires de Montréal 139 pièces, et nous en oublions 39. Contentons-nous de quelques traits. Deux ans après son arrivée, le 25 octobre 1661, Cuillerier faillit être tué au massacre de l’île à la Pierre où périt l’abbé Vignal et quelques autres Français. Emmené prisonnier au canton des Onnéiouts, il reçut la bastonnade et eut des ongles arrachés. On allait le brûler lorsque la soeur d’un capitaine tué au combat le demanda pour tenir la place de son frère. Dix-neuf mois s’écoulèrent. Un jour qu’il avait suivi les Onnéiouts à la chasse, il réussit à s’enfuir jusqu’à Orange, d’où il regagna Montréal. En 1665, René Cuillerier épousa Marie Lucault, dont le père Léonard Lucault avait été tué par les Iroquois. Toute la noblesse de Montréal voulut être de la noce, et Charles d’Ailleboust des Musseaux, neveu du gouverneur de ce nom, rédigea de sa main le contrat de mariage. Lorsque Lachine naquit, Cuillerier en fut l’un des notables. Sa maison fortifiée s'appela le fort Cuillerier. Durant l’hiver 1675-1676, l’abbé Guyotte, sulpicien, s’y fit bâtir une chapelle au fief Verdun (Lachine) de concert avec René Cuillerier, premier marguillier du lieu agissant au nom de la fabrique. Cultivateur et négociant, cet homme estimable atteignit à une honnête aisance. Son testament daté le 22 mars 1712 témoigne des plus purs sentiments chrétiens. Il semble avoir quitté cette terre en 1716, à 76 .ans40. Il laissait onze enfants mariés, des seize que le Ciel lui avait donnés. Les milliers de Cuillerier et Cuerrier actuels ont droit d'être fiers de leur ancêtre.
(1639-1712) CUILLERIER, RENÉ, engagé de l'Hôtel-Dieu de Montréal, colon, né probablement à Veron, diocèse d'Angers, vers 1639, fils de Julien Cuillerier et de Julienne Faifeu, décédé à Montréal vers 1712.
René Cuillerier arrive en Nouvelle-France le 7 septembre 1659. Il signe un engagement avec soeur Judith Moreau de Brésoles, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal, devant le notaire A. Demontreau à La Rochelle, le 8 juin 1659.
Par cet acte, il devient serviteur de l'hôpital de Ville-Marie à un salaire annuel de 75ª. Dès l'automne, il est à Montréal et, le 25 octobre 1661, avec quelques colons secondés de membres de la garnison et dirigés par l'abbé Guillaume Vignal, il se rend à l'île à la Pierre, dans le Saint-Laurent, pour y extraire des matériaux destinés à l'achèvement de la contruction du premier séminaire de Montréal.
Mal lui en prit, car les Iroquois, qui rôdaient dans les environs, attaquent les travailleurs, en tuent quelques-uns, en blessent d'autres et capturent Vignal, Claude de Brigeac, Cuillerier et Jacques Dufresne. Cuillerier et Brigeac sont emmenés en captivité chez les Onneiouts. Ils reçoivent la bastonnade et Cuillerier a les ongles arrachés. Les Indiens décident alors de brûler les deux Français. Brigeac est supplicié le premier, mais Cuillerier est sauvé par une Indienne qui demanda à l'adopter « afin de lui tenir la place de son frère ». Durant sa captivité qui dure 19 mois, il rencontre d'autres compagnons d'infortune : Michel Messier, dit Saint-Michel, et Urbain Tessier, dit Lavigne.
Au printemps de 1663, Cuillerier profite d'une partie de chasse avec les Onneiouts, auxquels s'étaient joints des Agniers et quelques Français captifs, pour s'enfuir vers la Nouvelle-Hollande. Il se rend au fort Orange, d'où il passe à Boston pour atteindre finalement Québec. De retour à Montréal à la fin de l'été, il reprend son service chez les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu.
Le 20 mai 1665, il s'établit sur l'île de Montréal, ayant obtenu des Sulpiciens une concession de 45 arpents. Cette terre fera partie du fief de Verdun, concédé en 1671. Il participe à la fondation de Lachine et en devient le premier marguillier en 1675. L'année suivante, sa maison fortifiée prend le nom de fort Cuillerier. Au recensement de 1681, il a 32 arpents en valeur et il possède six fusils, un pistolet et six bêtes à cornes.
Malade depuis un certain temps, Cuillerier fait son testament le 22 mars 1712 devant le curé Louis-Michel de Vilermaula de Lachine. Ses dernières volontés sont déposées dans le greffe de Jean-Baptiste Adhémar le 26 janvier 1716. Même si la date de sa mort nous est inconnue, un acte notarié du 27 janvier 1718, passé devant le notaire Adhémar et déposé dans le greffe de Michel Lepallieur, nous signale que la dame Lucault est « demeuré veufve dud Sieur son époux depuis plus de Cinq ans ».
René Cuillerier a épousé, le 13 avril 1665, dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Marie Lucault, fille de Léonard Barbeau, dit Lucault, et de Barbe Poisson. De ce mariage sont nés 16 enfants, dont 7 sont baptisés à Montréal et les autres à Lachine.
(Perrault, Claude, "Dictionnaire biographique du Canada", vol. 2)