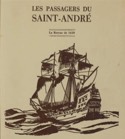Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Arbre Généalogique Guertin Rondeau Family Tree - Person Sheet
Birth20 Jul 1629, Tours, Touraine, Indre-et-Loire, France
Christening20 Jul 1629, Saint-Symphorien, Tours, France2
Death31 May 1704, Montréal, Québec, Canada
Burial31 May 1704, Notre-Dame-De-Montréal, Montréal, Québec, Canada2
FlagsBiography, Fille du Roi
FatherPierre Leclerc
MotherNicole Petit
Spouses
Birth3 Nov 1637, La Flèche, France
Christening3 Nov 1637, Saint-Lambert De Clermont, Maine, France2
Death1 Oct 1730, Montréal, Québec, Canada2
Burial2 Oct 1730, Notre-Dame-De-Montréal, Montréal, Québec, Canada2
FlagsLa Recrue de 1659, Ship Saint-André
MotherRadegonde Marchand
Marriage26 Nov 1665, Notre-Dame-De-Montréal, Montréal, Québec, Canada2
ChildrenJeanne-Marguerite (1667-1747)
Notes for Marguerite Leclerc
2Fille du Roi, arrivée en 16653
20Marguerite Leclerc (1629-1704)
Autres graphies : Leclercq, Leclere.
Ses origines
Marguerite est baptisée le 20 juillet 1629 dans la paroisse de Saint-Symphorien de Tours, en Touraine, dans une modeste église érigée au xii e siècle. Son père est Pierre Leclerc et sa mère Nicole Petit. Nous ignorons si Marguerite a eu des frères ou des sœurs ou si des membres de sa parenté l’ont précédée au Canada. En 1665, était-elle orpheline au moment de son embarquement ? Nous l’ignorons aussi. Quoi qu’il en soit, Marguerite, à 36 ans, monte à bord d’un navire en partance pour la Nouvelle-France, probablement le Saint-Jean-Baptiste de Dieppe avec plus d’une centaine de passagers, dont 90 Filles du Roy et femmes et 30 hommes engagés. Le navire appartenant à Aubert de La Chenaye, placé sous le commandement de François Fillye, mouille devant Québec le 18 juin 1665. Dès lors, Marguerite Leclerc, femme faite, valide, ne sachant pas signer son nom, commence une nouvelle vie.
Son mariage
À l’automne de la même année, on retrouve Marguerite à Montréal. Le dimanche 22 novembre, elle contracte mariage devant le notaire Nicolas De Mouchy avec Julien Beloy (Blois, Belois, Benoist…),
qu’elle épouse à Notre-Dame de Montréal le jeudi suivant, le 26 novembre 1665. Ne sont présentes au mariage que trois personnes : Jean Gervaise, Pierre Caille et le célébrant, le prêtre Gabriel Souart. Julien Beloy est huit ans plus jeune que Marguerite. Cependant, l’année suivante, lors du recensement à Montréal, tous deux déclarent avoir 27 ans, alors que Marguerite en a 37 et Julien 29.
De fait, Julien Beloy a été baptisé le 3 novembre 1637 à Clermont-Créans, près de La Flèche, évêché de Le Mans en Maine. Son père est Julien Beloy, sieur de Servigny, et sa mère est Radegonde Marchand. Son parrain est Guillaume Lemarchand et sa marraine Catherine Jouye. Son cousin Jean Gateau (Gatteau, Gasteau), une recrue de 1653, est déjà installé en Nouvelle-France. Alors, à 22 ans, en juin 1659, Julien Beloy décide de partir lui aussi. Il signe chez le notaire Alexandre Demontreau de La Rochelle un engagement de cinq ans comme défricheur pour le compte des Sulpiciens à Montréal. Avec trois autres compagnons, il accompagne le père Souart sur Le Saint-André qui arrive le 29 septembre 1659 à Québec. En février 1663, Julien Beloy fait bien partie de la population de Montréal, puisque son nom figure dans la 11 e escouade, sur la vingtaine composant la milice de la Sainte-Famille levée par Maisonneuve pour défendre le territoire contre les Iroquois. Julien Beloy complète son contrat de cinq ans, à la fin duquel il est en mesure de s’établir. Il choisit la côte Saint-François (Longue-Pointe) où il acquiert, de Jacques David dit Lapointe, pour la somme de 66 livres, 30 arpents de terre. Cela se passe le 27 novembre 1666, un an presque jour pour jour après son mariage avec Marguerite.
Sa famille
Un mois et demi plus tard, Marguerite donne naissance à leur premier enfant, une fille baptisée du nom de Jeanne Marguerite Beloy, le 14 janvier 1667. Le cousin de Julien, Jean Gateau, qui a épousé une Fille du Roy de 1666, Charlotte de Coppequesne, est le parrain de la petite, et Jeanne Groisard, aussi Fille du Roy arrivée en 1665, en est la marraine. Jeanne Marguerite, fille aînée de la famille Beloy-Leclerc, quitte la maison paternelle à l’âge de treize ans pour épouser un domestique de 32 ans, Adrien St-Aubin, le 19 février 1680. Ni Marguerite Leclerc, ni Julien Beloy, ni la belle-mère, Jacqueline Presot, ni le beau-père, Adrien St-Aubin, ne sont présents à ce mariage célébré par le curé Gilles Perot à Montréal. Cependant, on note la présence de Charles Le Moyne de Longueuil, l’employeur du marié, et celle de huit autres personnes, dont le parrain de la mariée, Jean Gateau, et son épouse Charlotte de Coppequesne.
Le couple St-Aubin–Beloy s’établit à Boucherville et aura six enfants : Julien naît en juin 1683 et se mariera en 1704 avec Suzanne Courraud Lacoste ; Marguerite naît en mai 1688 et se mariera en 1709 avec Louis Jared Beauregard ; Jeanne naît en décembre 1691 et se mariera en 1712 avec Jean Philippe Baptiste Lamarre ; Marie naît en juillet 1694 et se mariera en 1717 avec Pierre Turcot ; Marie Charlotte naît en septembre 1696 et se mariera en 1717 avec François Mathurin Bonneron Dumaine ; enfin, Michel naît vers 1700. Aucun acte de baptême, de mariage ou de sépulture n’est connu pour ce dernier enfant du couple. Jeanne Marguerite devient veuve peu après puisqu’elle se remarie avec Pierre Émard (Haimard, Aymard) de Potvin, le 6 février 1702, à Longueuil, à l’âge de 35 ans. De cette union naissent six autres enfants, dont deux filles. La première, Marie Anne, naît en novembre 1702 et se mariera en 1732 avec Pierre Betourne ; puis un fils naît en octobre 1704, Pierre, qui se mariera en 1745 avec Marie Geneviève Daigneau ; la seconde fille, Marie Josephe, naît en décembre 1706 et se mariera en 1730 avec Antoine Benoit Livernois ; Joseph naît en décembre 1708 et ne se mariera pas ; Antoine naît en mars 1711 et se mariera en 1738 avec Marie Josephe Bourgery ; enfin, Vincent naît en août 1714 et se mariera en 1740 avec Marie Élisabeth Bourdon.
Le deuxième enfant que Marguerite Leclerc met au monde est un garçon. Il est baptisé par le curé Gilles Perot le 14 février 1670 sous le nom de Julien Beloy en présence de ses père et mère, de Pierre Baraux et de Louise Texier (Tessier), parrain et marraine. Il décède à 17 ans. Il est noté dans l’acte de sépulture du 3 septembre 1687 qu’il est décédé « appres avoir este muny des sacrements exceptée l’extreme onction ». Est-ce à la suite d’une maladie ou d’un accident ? On ne le sait pas.
Le troisième enfant de Marguerite Leclerc est une fille, Charlotte Marguerite, baptisée le 15 avril 1672 par le même curé, Gilles Perot. Les parents sont présents au baptême ainsi que Pierre Caille et Charlotte de Coppequesne, Fille du Roy de 1666, comme parrain et marraine. Cette deuxième fille quitte aussi très jeune la maison paternelle, à 14 ans, pour se marier, le 25 novembre 1686. Elle épouse Vincent Lenoir, un maître-menuisier de 25 ans, originaire d’Azay-Le-Rideau, diocèse de Tours. Marguerite Leclerc et son mari ne sont pas présents au mariage de leur fille, non plus que le père du marié, Bertrand Lenoir, qui est décédé, ni sa mère, Jeanne Cuschereau. La famille Lenoir-Beloy, établie à Montréal, comptera six enfants : François naît en avril 1691 et ne se marie pas ; Vincent naît en avril 1693 et se mariera en 1734 avec Marie Angélique Larrivée ; Françoise naît en avril 1695 et deviendra sœur SainteÉlisabeth de la Congrégation de Notre-Dame; Joseph naît en mai 1698 et se mariera en 1719 avec Marie Catherine Millet ; les deux dernières filles, Marie, née en avril 1700, et Jeanne Charlotte, née en août 1702, mourront toutes deux en 1703, au temps de la petite vérole.
Marguerite Leclerc donne naissance à son quatrième et dernier enfant à l’âge de 45 ans. Il s’agit du petit Jean qui n’atteindra pas 5 ans. Baptisé le 24 novembre 1674 par le curé Gilles Perot, l’enfant décède le 28 octobre 1678. Son parrain est Jean Regnaut et sa marraine Jeanne Gervaise, fille de Jean, le substitut du procureur, et d’Anne Archambault.
Un mari prospère, mais belliqueux
Julien Beloy n’est pas passé du statut de jeune engagé-défricheur en 1659 à propriétaire terrien et homme d’affaires à son décès, le 1er octobre 1730, sans avoir fait montre d’une grande détermination et d’une certaine autorité. Marguerite Leclerc partage donc la vie d’un homme ambitieux et âpre au gain qui a toujours eu à son service des engagés dans l’exploitation de ses terres. Julien Beloy entre en conflit avec certains d’entre eux et leur intente des procès. Dans d’autres différends, on l’accuse de violence à l’endroit de femmes.
Dès février 1669, Julien Beloy achète de son voisin, Pierre Perthuis, 15 arpents de terre pour 95 livres et, en septembre 1671, pour 90 livres, il met Nicolas Joly sous contrat d’homme engagé d’une durée de sept mois.
En juillet 1673, il obtient des Sulpiciens un emplacement de 40 pieds de façade sur la rue Saint-Paul, qu’il vend trois ans plus tard à Pierre Roussel pour la somme de 120 livres.
C’est encore à Longue-Pointe qu’il investit en mars 1678, en acquérant 34 arpents de terre ; le recensement de 1681 l’inscrit à cet endroit, en possession de 25 arpents mis en valeur et de 7 bêtes à cornes.
En août 1682, il donne quittance à son gendre Adrien St-Aubin des 300 livres promises lors du contrat de mariage de sa fille aînée.
En décembre 1686, 90 autres arpents provenant des Sulpiciens viennent grossir son lot au bout des 6 autres arpents de front qu’il possède déjà ;
Au cours de l’année 1687, il doit débourser 150 livres pour régler hors cour une accusation d’injure et de voie de fait sur la personne de Marie Tétreau, épouse de Paul Desmarais. Cette dernière témoigne contre Beloy dans une autre affaire de violence sur une femme, huit ans plus tard, en 1695. Il s’agit d’Élizabeth Cusson, épouse de Joseph Aubuchon, que Beloy a injuriée et rouée de coups.
En mai 1688, Beloy commence à louer des parcelles de terre. D’abord aux frères Lelat avec l’usage de 4 bœufs, 3 vaches, 3 veaux, 4 cochons, 24 poules et 1 coq. Puis en 1695, pour trois ans, il loue six arpents de sa terre avec maison, grange et bâtiments à Jacques Desnoyers dit Lajeunesse, contre la moitié des grains et profits, se gardant sur place l’usage du jardin et d’un logis. Cette entente vire au vinaigre trois ans plus tard quand Beloy intente à Desnoyers un procès pour dommages causés par l’écoulement des eaux.
En 1689, une enfant de six ou sept ans, Élizabeth Drouet, est engagée au service de Beloy pour une durée de dix ans, alors que Jean Gruet, un des engagés qui avait quitté son service, doit revenir compléter son contrat d’engagement à raison de 135 livres. Un nouveau différend surgit en 1692 avec un domestique, Antoine Cougnon, que Beloy accuse d’avoir quitté son service sans son consentement.
Dans le but de s’établir éventuellement à Montréal, Beloy achète d’Urbain Gervaise en novembre 1695 un terrain d’un demi-arpent près de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours.
De fait, en 1703, il y est déménagé. Il fait un bail à loyer de sa terre à Longue-Pointe à ses deux gendres, Vincent Lenoir de Montréal et Pierre Haimard de Longueuil.
Beloy emploie son petit-fils Julien St-Aubin, car, en janvier 1703, il conclut une entente au sujet de ses gages qu’il règle pour la somme de 10 livres, mais le jeune homme de vingt ans doit renoncer à toutes prétentions sur les grains qu’il a semés sur la terre de son grand-père.
Julien Beloy s’est acquis, dès 1686, le surnom révélateur de Brasdargent, à défaut de celui de Brasdefer, qui lui aurait tout aussi bien convenu. Marguerite Leclerc a-t-elle subi des violences conjugales ? Il est permis de le croire, car un homme qui levait la main sur les épouses des autres ne se privait habituellement pas avec la sienne.
Une grand-maman éloignée des siens
Marguerite Leclerc a vécu dix-sept ans seule avec son époux et maître Julien Beloy, à compter du décès de son fils Julien en 1687, ses deux filles étant déjà parties pour se marier, en 1680 et 1686. Comme Jeanne Marguerite s’était établie à Boucherville, Marguerite Leclerc n’a sans doute pas profité de son entourage. Non plus que de la présence de Charlotte Marguerite qui avait quitté la maison à 14 ans en rupture avec ses parents. En février 1703, le malheur frappe chez les Lenoir : Charlotte Marguerite et sa fille Marie meurent à quelques jours d’intervalle, sans doute de la petite vérole qui sévit de novembre 1702 à juin 1703. L’autre petite-fille de Charlotte Marguerite, Jeanne Charlotte, meurt en juin, probablement de la même maladie. Marguerite Leclerc est alors grand-mère de onze petits-enfants sur les dix-huit que ses filles lui auront donnés. Elle ne connaîtra pas les cinq derniers, car ils naissent après son décès.
Son décès
Celui-ci survient en mai 1704, elle a 75 ans. Le registre de sépulture montre que Marguerite Leclerc est inhumée le 31 de ce mois à Montréal, en présence de deux prêtres du Séminaire de Ville-Marie, Michel Barthelemy et Antoine Devalens.
Dans le mois qui suit le décès de son épouse, Julien Beloy fait une donation de rente annuelle et perpétuelle à la Fabrique de l’église Notre-Dame de Montréal, puis il envisage de se remarier. Chose faite le 11 août 1704, après moins de trois mois de veuvage. Il épouse Marie Françoise Goupil, veuve de Cybard de Courraud Lacoste, mère de six enfants, dont deux filles non mariées. Les familles Beloy et Courraud étaient déjà liées par le mariage du fils de Jean Gasteau et de Charlotte de Coppequesne, aussi nommé Jean Gasteau, avec Suzanne Peronnelle Courraud et par le remariage de celle-ci, en février 1704, avec Julien Saint-Aubin, l’aîné des petits-enfants Beloy.
Le mois suivant son remariage, le 27 septembre, Julien Beloy procède à l’inventaire après décès des biens de Marguerite Leclerc. Chez le notaire Pierre Raimbault, il fait le partage avec sa fille Jeanne Marguerite et les trois enfants mineurs de Charlotte Marguerite, décédée l’année précédente. Afin de ne pas perdre dans une vente à l’encan les biens à partager, Julien Beloy en vient à une entente avec son gendre Pierre Aymard, tuteur de ses enfants mineurs.
Le nom de Marguerite Leclerc
Le plus grand legs que Marguerite Leclerc laisse à ses descendants est sans nul doute celui du dévouement et de l’amour maternels. Dans la force de l’âge, elle a enfanté plusieurs fois et, malgré le caractère impétueux de son époux, elle a réussi à rendre le foyer des siens accueillant. Marguerite Leclerc a élevé deux filles qui ont contribué honorablement au peuplement de la Nouvelle-France en mettant au monde dix-huit enfants qui ont fait souche. La contribution à la nation québécoise de Marguerite Leclerc, cette « vieille » fille de Touraine, est remarquable et elle mérite d’être soulignée.
Lise Hébert 20
20Marguerite Leclerc (1629-1704)
Autres graphies : Leclercq, Leclere.
Ses origines
Marguerite est baptisée le 20 juillet 1629 dans la paroisse de Saint-Symphorien de Tours, en Touraine, dans une modeste église érigée au xii e siècle. Son père est Pierre Leclerc et sa mère Nicole Petit. Nous ignorons si Marguerite a eu des frères ou des sœurs ou si des membres de sa parenté l’ont précédée au Canada. En 1665, était-elle orpheline au moment de son embarquement ? Nous l’ignorons aussi. Quoi qu’il en soit, Marguerite, à 36 ans, monte à bord d’un navire en partance pour la Nouvelle-France, probablement le Saint-Jean-Baptiste de Dieppe avec plus d’une centaine de passagers, dont 90 Filles du Roy et femmes et 30 hommes engagés. Le navire appartenant à Aubert de La Chenaye, placé sous le commandement de François Fillye, mouille devant Québec le 18 juin 1665. Dès lors, Marguerite Leclerc, femme faite, valide, ne sachant pas signer son nom, commence une nouvelle vie.
Son mariage
À l’automne de la même année, on retrouve Marguerite à Montréal. Le dimanche 22 novembre, elle contracte mariage devant le notaire Nicolas De Mouchy avec Julien Beloy (Blois, Belois, Benoist…),
qu’elle épouse à Notre-Dame de Montréal le jeudi suivant, le 26 novembre 1665. Ne sont présentes au mariage que trois personnes : Jean Gervaise, Pierre Caille et le célébrant, le prêtre Gabriel Souart. Julien Beloy est huit ans plus jeune que Marguerite. Cependant, l’année suivante, lors du recensement à Montréal, tous deux déclarent avoir 27 ans, alors que Marguerite en a 37 et Julien 29.
De fait, Julien Beloy a été baptisé le 3 novembre 1637 à Clermont-Créans, près de La Flèche, évêché de Le Mans en Maine. Son père est Julien Beloy, sieur de Servigny, et sa mère est Radegonde Marchand. Son parrain est Guillaume Lemarchand et sa marraine Catherine Jouye. Son cousin Jean Gateau (Gatteau, Gasteau), une recrue de 1653, est déjà installé en Nouvelle-France. Alors, à 22 ans, en juin 1659, Julien Beloy décide de partir lui aussi. Il signe chez le notaire Alexandre Demontreau de La Rochelle un engagement de cinq ans comme défricheur pour le compte des Sulpiciens à Montréal. Avec trois autres compagnons, il accompagne le père Souart sur Le Saint-André qui arrive le 29 septembre 1659 à Québec. En février 1663, Julien Beloy fait bien partie de la population de Montréal, puisque son nom figure dans la 11 e escouade, sur la vingtaine composant la milice de la Sainte-Famille levée par Maisonneuve pour défendre le territoire contre les Iroquois. Julien Beloy complète son contrat de cinq ans, à la fin duquel il est en mesure de s’établir. Il choisit la côte Saint-François (Longue-Pointe) où il acquiert, de Jacques David dit Lapointe, pour la somme de 66 livres, 30 arpents de terre. Cela se passe le 27 novembre 1666, un an presque jour pour jour après son mariage avec Marguerite.
Sa famille
Un mois et demi plus tard, Marguerite donne naissance à leur premier enfant, une fille baptisée du nom de Jeanne Marguerite Beloy, le 14 janvier 1667. Le cousin de Julien, Jean Gateau, qui a épousé une Fille du Roy de 1666, Charlotte de Coppequesne, est le parrain de la petite, et Jeanne Groisard, aussi Fille du Roy arrivée en 1665, en est la marraine. Jeanne Marguerite, fille aînée de la famille Beloy-Leclerc, quitte la maison paternelle à l’âge de treize ans pour épouser un domestique de 32 ans, Adrien St-Aubin, le 19 février 1680. Ni Marguerite Leclerc, ni Julien Beloy, ni la belle-mère, Jacqueline Presot, ni le beau-père, Adrien St-Aubin, ne sont présents à ce mariage célébré par le curé Gilles Perot à Montréal. Cependant, on note la présence de Charles Le Moyne de Longueuil, l’employeur du marié, et celle de huit autres personnes, dont le parrain de la mariée, Jean Gateau, et son épouse Charlotte de Coppequesne.
Le couple St-Aubin–Beloy s’établit à Boucherville et aura six enfants : Julien naît en juin 1683 et se mariera en 1704 avec Suzanne Courraud Lacoste ; Marguerite naît en mai 1688 et se mariera en 1709 avec Louis Jared Beauregard ; Jeanne naît en décembre 1691 et se mariera en 1712 avec Jean Philippe Baptiste Lamarre ; Marie naît en juillet 1694 et se mariera en 1717 avec Pierre Turcot ; Marie Charlotte naît en septembre 1696 et se mariera en 1717 avec François Mathurin Bonneron Dumaine ; enfin, Michel naît vers 1700. Aucun acte de baptême, de mariage ou de sépulture n’est connu pour ce dernier enfant du couple. Jeanne Marguerite devient veuve peu après puisqu’elle se remarie avec Pierre Émard (Haimard, Aymard) de Potvin, le 6 février 1702, à Longueuil, à l’âge de 35 ans. De cette union naissent six autres enfants, dont deux filles. La première, Marie Anne, naît en novembre 1702 et se mariera en 1732 avec Pierre Betourne ; puis un fils naît en octobre 1704, Pierre, qui se mariera en 1745 avec Marie Geneviève Daigneau ; la seconde fille, Marie Josephe, naît en décembre 1706 et se mariera en 1730 avec Antoine Benoit Livernois ; Joseph naît en décembre 1708 et ne se mariera pas ; Antoine naît en mars 1711 et se mariera en 1738 avec Marie Josephe Bourgery ; enfin, Vincent naît en août 1714 et se mariera en 1740 avec Marie Élisabeth Bourdon.
Le deuxième enfant que Marguerite Leclerc met au monde est un garçon. Il est baptisé par le curé Gilles Perot le 14 février 1670 sous le nom de Julien Beloy en présence de ses père et mère, de Pierre Baraux et de Louise Texier (Tessier), parrain et marraine. Il décède à 17 ans. Il est noté dans l’acte de sépulture du 3 septembre 1687 qu’il est décédé « appres avoir este muny des sacrements exceptée l’extreme onction ». Est-ce à la suite d’une maladie ou d’un accident ? On ne le sait pas.
Le troisième enfant de Marguerite Leclerc est une fille, Charlotte Marguerite, baptisée le 15 avril 1672 par le même curé, Gilles Perot. Les parents sont présents au baptême ainsi que Pierre Caille et Charlotte de Coppequesne, Fille du Roy de 1666, comme parrain et marraine. Cette deuxième fille quitte aussi très jeune la maison paternelle, à 14 ans, pour se marier, le 25 novembre 1686. Elle épouse Vincent Lenoir, un maître-menuisier de 25 ans, originaire d’Azay-Le-Rideau, diocèse de Tours. Marguerite Leclerc et son mari ne sont pas présents au mariage de leur fille, non plus que le père du marié, Bertrand Lenoir, qui est décédé, ni sa mère, Jeanne Cuschereau. La famille Lenoir-Beloy, établie à Montréal, comptera six enfants : François naît en avril 1691 et ne se marie pas ; Vincent naît en avril 1693 et se mariera en 1734 avec Marie Angélique Larrivée ; Françoise naît en avril 1695 et deviendra sœur SainteÉlisabeth de la Congrégation de Notre-Dame; Joseph naît en mai 1698 et se mariera en 1719 avec Marie Catherine Millet ; les deux dernières filles, Marie, née en avril 1700, et Jeanne Charlotte, née en août 1702, mourront toutes deux en 1703, au temps de la petite vérole.
Marguerite Leclerc donne naissance à son quatrième et dernier enfant à l’âge de 45 ans. Il s’agit du petit Jean qui n’atteindra pas 5 ans. Baptisé le 24 novembre 1674 par le curé Gilles Perot, l’enfant décède le 28 octobre 1678. Son parrain est Jean Regnaut et sa marraine Jeanne Gervaise, fille de Jean, le substitut du procureur, et d’Anne Archambault.
Un mari prospère, mais belliqueux
Julien Beloy n’est pas passé du statut de jeune engagé-défricheur en 1659 à propriétaire terrien et homme d’affaires à son décès, le 1er octobre 1730, sans avoir fait montre d’une grande détermination et d’une certaine autorité. Marguerite Leclerc partage donc la vie d’un homme ambitieux et âpre au gain qui a toujours eu à son service des engagés dans l’exploitation de ses terres. Julien Beloy entre en conflit avec certains d’entre eux et leur intente des procès. Dans d’autres différends, on l’accuse de violence à l’endroit de femmes.
Dès février 1669, Julien Beloy achète de son voisin, Pierre Perthuis, 15 arpents de terre pour 95 livres et, en septembre 1671, pour 90 livres, il met Nicolas Joly sous contrat d’homme engagé d’une durée de sept mois.
En juillet 1673, il obtient des Sulpiciens un emplacement de 40 pieds de façade sur la rue Saint-Paul, qu’il vend trois ans plus tard à Pierre Roussel pour la somme de 120 livres.
C’est encore à Longue-Pointe qu’il investit en mars 1678, en acquérant 34 arpents de terre ; le recensement de 1681 l’inscrit à cet endroit, en possession de 25 arpents mis en valeur et de 7 bêtes à cornes.
En août 1682, il donne quittance à son gendre Adrien St-Aubin des 300 livres promises lors du contrat de mariage de sa fille aînée.
En décembre 1686, 90 autres arpents provenant des Sulpiciens viennent grossir son lot au bout des 6 autres arpents de front qu’il possède déjà ;
Au cours de l’année 1687, il doit débourser 150 livres pour régler hors cour une accusation d’injure et de voie de fait sur la personne de Marie Tétreau, épouse de Paul Desmarais. Cette dernière témoigne contre Beloy dans une autre affaire de violence sur une femme, huit ans plus tard, en 1695. Il s’agit d’Élizabeth Cusson, épouse de Joseph Aubuchon, que Beloy a injuriée et rouée de coups.
En mai 1688, Beloy commence à louer des parcelles de terre. D’abord aux frères Lelat avec l’usage de 4 bœufs, 3 vaches, 3 veaux, 4 cochons, 24 poules et 1 coq. Puis en 1695, pour trois ans, il loue six arpents de sa terre avec maison, grange et bâtiments à Jacques Desnoyers dit Lajeunesse, contre la moitié des grains et profits, se gardant sur place l’usage du jardin et d’un logis. Cette entente vire au vinaigre trois ans plus tard quand Beloy intente à Desnoyers un procès pour dommages causés par l’écoulement des eaux.
En 1689, une enfant de six ou sept ans, Élizabeth Drouet, est engagée au service de Beloy pour une durée de dix ans, alors que Jean Gruet, un des engagés qui avait quitté son service, doit revenir compléter son contrat d’engagement à raison de 135 livres. Un nouveau différend surgit en 1692 avec un domestique, Antoine Cougnon, que Beloy accuse d’avoir quitté son service sans son consentement.
Dans le but de s’établir éventuellement à Montréal, Beloy achète d’Urbain Gervaise en novembre 1695 un terrain d’un demi-arpent près de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours.
De fait, en 1703, il y est déménagé. Il fait un bail à loyer de sa terre à Longue-Pointe à ses deux gendres, Vincent Lenoir de Montréal et Pierre Haimard de Longueuil.
Beloy emploie son petit-fils Julien St-Aubin, car, en janvier 1703, il conclut une entente au sujet de ses gages qu’il règle pour la somme de 10 livres, mais le jeune homme de vingt ans doit renoncer à toutes prétentions sur les grains qu’il a semés sur la terre de son grand-père.
Julien Beloy s’est acquis, dès 1686, le surnom révélateur de Brasdargent, à défaut de celui de Brasdefer, qui lui aurait tout aussi bien convenu. Marguerite Leclerc a-t-elle subi des violences conjugales ? Il est permis de le croire, car un homme qui levait la main sur les épouses des autres ne se privait habituellement pas avec la sienne.
Une grand-maman éloignée des siens
Marguerite Leclerc a vécu dix-sept ans seule avec son époux et maître Julien Beloy, à compter du décès de son fils Julien en 1687, ses deux filles étant déjà parties pour se marier, en 1680 et 1686. Comme Jeanne Marguerite s’était établie à Boucherville, Marguerite Leclerc n’a sans doute pas profité de son entourage. Non plus que de la présence de Charlotte Marguerite qui avait quitté la maison à 14 ans en rupture avec ses parents. En février 1703, le malheur frappe chez les Lenoir : Charlotte Marguerite et sa fille Marie meurent à quelques jours d’intervalle, sans doute de la petite vérole qui sévit de novembre 1702 à juin 1703. L’autre petite-fille de Charlotte Marguerite, Jeanne Charlotte, meurt en juin, probablement de la même maladie. Marguerite Leclerc est alors grand-mère de onze petits-enfants sur les dix-huit que ses filles lui auront donnés. Elle ne connaîtra pas les cinq derniers, car ils naissent après son décès.
Son décès
Celui-ci survient en mai 1704, elle a 75 ans. Le registre de sépulture montre que Marguerite Leclerc est inhumée le 31 de ce mois à Montréal, en présence de deux prêtres du Séminaire de Ville-Marie, Michel Barthelemy et Antoine Devalens.
Dans le mois qui suit le décès de son épouse, Julien Beloy fait une donation de rente annuelle et perpétuelle à la Fabrique de l’église Notre-Dame de Montréal, puis il envisage de se remarier. Chose faite le 11 août 1704, après moins de trois mois de veuvage. Il épouse Marie Françoise Goupil, veuve de Cybard de Courraud Lacoste, mère de six enfants, dont deux filles non mariées. Les familles Beloy et Courraud étaient déjà liées par le mariage du fils de Jean Gasteau et de Charlotte de Coppequesne, aussi nommé Jean Gasteau, avec Suzanne Peronnelle Courraud et par le remariage de celle-ci, en février 1704, avec Julien Saint-Aubin, l’aîné des petits-enfants Beloy.
Le mois suivant son remariage, le 27 septembre, Julien Beloy procède à l’inventaire après décès des biens de Marguerite Leclerc. Chez le notaire Pierre Raimbault, il fait le partage avec sa fille Jeanne Marguerite et les trois enfants mineurs de Charlotte Marguerite, décédée l’année précédente. Afin de ne pas perdre dans une vente à l’encan les biens à partager, Julien Beloy en vient à une entente avec son gendre Pierre Aymard, tuteur de ses enfants mineurs.
Le nom de Marguerite Leclerc
Le plus grand legs que Marguerite Leclerc laisse à ses descendants est sans nul doute celui du dévouement et de l’amour maternels. Dans la force de l’âge, elle a enfanté plusieurs fois et, malgré le caractère impétueux de son époux, elle a réussi à rendre le foyer des siens accueillant. Marguerite Leclerc a élevé deux filles qui ont contribué honorablement au peuplement de la Nouvelle-France en mettant au monde dix-huit enfants qui ont fait souche. La contribution à la nation québécoise de Marguerite Leclerc, cette « vieille » fille de Touraine, est remarquable et elle mérite d’être soulignée.
Lise Hébert 20
Notes for Julien (Spouse 1)
11Engagé de la recrue de 1659
arrive a Montreal 29 septembre 1659
11* Bloys8, Julien, sieur de Servigny fsigne « Servigny » en 1694 : BRH, 1909, 24), fils de Julien et de Radegonde Marchand, fut baptisé à Clermont (Sarthe) au Maine, le 3 novembre 1637. Il était « cousin maternel » du colon Jean Gasteau (gr. Basset, 5 déc. 1666). Le 8 juin 1659, .se trouvant à La Rochelle, dans l’étude de Demontreau, il s’engageait à Mr de la Dauversière stipulant pour l’abbé Souard, à aller travailler à Montréal durant cinq ans au salaire de 70 livres par an. Il fut placé, en 1663, par Maisonneuve dans la 1 le escouade de la milice de la Ste-Famille (Faillon, Hist., Ill, 17). Julien Bloys contracta deux unions à Montréal : 1° le 26 novembre 1665 (contrat, de Monchy, 22 nov.) avec Marguerite Leclerc, qui fut inhumée à Montréal le 31 mai 1704, inventaire du 27 septembre suivant (gr. Raimbault) ; 2° le 11 août 1704 (contrat, Lepailleur, 8 août) avec Françoise Goupil, veuve de Cybar Courault. Le recensement de 1667 (Suite, Hist., IV, 76b) mentionne Julien Belloy, à Montréal près de Nicolas Forget, ayant 3 arpents de terre en valeur. Peut-être est-ce là la terre de 2 x 15 arpents, sise à la côte St-François (Longue-Pointe), entre Pierre Gagné et René Dardenne, qu’il avait achetée au prix de 70 livres de Jacques David dit Lapointe le 27 novembre 1666 (gr. Basset). Cette propriété sera augmentée par l’achat d'un autre arpent de large, de Pierre Perthuis, successeur de René Dardenne, le 9 février 1669 (gr. Basset; cf. Adhémar, 14 fév. 1709), et d’une « continuation » de 6 x 15 arpents, le 30 décembre 1686 (gr. Basset) ; en sorte que Julien Belloy pouvait déclarer au
(8 — Variantes. A Clermont on écrivait Belois et Beloys. loy, Au Canada Beloy, Belloys et Bloys (gr. Basset) Beloy, Blois, Bloye, etc.)
recensement de 1681 (Suite, Hist., V, 67e) «1 fusil, 7 bêtes à cornes et 25 arpents en valeur ». Le greffe Adhémar contient en outre, une acquisition d’Urbain Gervaise du 5 novembre 1695. Sur le Plan de l’île de Montréal de 1702, notre colon a une terre de 6 x 35 arpents entre Juillet au N.-E. et Goguet au S.-O.; dans l'Aveu de 1731, à la Longue-Pointe, il possède, entre François Blet et Pierre Goguet, un domaine de 6 x 55 arpents, avec 3 maisons, dont l’une en pierre, 3 granges, 3 étables, 92 arpents de terre labourable et 15 en prairie (RAPQ, 1941, p. 102). Pour atteindre ce degré de prospérité le Sr de Serigny avait eu l’aide d'engagés: Nicolas Joly (gr. Basset, 30 sept. 1671) et Jean Gruet dit Dame Jeanne (gr. Adhémar, 25 juill. 1689). Il avait aussi mis de la terre en fermage: aux frères Lelat, le 2 mai 1688 (gr. Basset) ; à Jacques Desnoyers, le 15 août 1695 (gr. Adhémar) à Dominique Nafrechoux (gr. Lepallieur, 25 nov. 1728 et Jug. Cons. Sup., III, 322; IV, 43). Outre sa terre à la Longue-Pointe, Julien Bloys s’était fait concéder en ville, rue St-Paul, un terrain de 40 pieds de front, aboutissant à la grève, par acte de Basset du 28 juillet 1673 (Terrier, n. 63) : mais il le revendit bientôt (gr. Basset, 22 juin 1676) au taillandier Pierre Roussel. Mentionnons enfin, au sujet de notre homme, un accord avec Julien St-Aubin, son petit-fils (gr. Adhémar, 17 janv. 1703), une donation à Monique Jean, sa belle-soeur (Jug. Cons. Souv., IV, 760) ; et une altercation avec Paul Desmarais qui se régla devant le notaire Adhémar, le 2 août 1687. Bloys et sa seconde femme moururent tous deux à 92 ans; ils furent inhumés à Montréal, lui, le 2 octobre 1730; elle, le 31 octobre 1747. Descendance féminine.
arrive a Montreal 29 septembre 1659
11* Bloys8, Julien, sieur de Servigny fsigne « Servigny » en 1694 : BRH, 1909, 24), fils de Julien et de Radegonde Marchand, fut baptisé à Clermont (Sarthe) au Maine, le 3 novembre 1637. Il était « cousin maternel » du colon Jean Gasteau (gr. Basset, 5 déc. 1666). Le 8 juin 1659, .se trouvant à La Rochelle, dans l’étude de Demontreau, il s’engageait à Mr de la Dauversière stipulant pour l’abbé Souard, à aller travailler à Montréal durant cinq ans au salaire de 70 livres par an. Il fut placé, en 1663, par Maisonneuve dans la 1 le escouade de la milice de la Ste-Famille (Faillon, Hist., Ill, 17). Julien Bloys contracta deux unions à Montréal : 1° le 26 novembre 1665 (contrat, de Monchy, 22 nov.) avec Marguerite Leclerc, qui fut inhumée à Montréal le 31 mai 1704, inventaire du 27 septembre suivant (gr. Raimbault) ; 2° le 11 août 1704 (contrat, Lepailleur, 8 août) avec Françoise Goupil, veuve de Cybar Courault. Le recensement de 1667 (Suite, Hist., IV, 76b) mentionne Julien Belloy, à Montréal près de Nicolas Forget, ayant 3 arpents de terre en valeur. Peut-être est-ce là la terre de 2 x 15 arpents, sise à la côte St-François (Longue-Pointe), entre Pierre Gagné et René Dardenne, qu’il avait achetée au prix de 70 livres de Jacques David dit Lapointe le 27 novembre 1666 (gr. Basset). Cette propriété sera augmentée par l’achat d'un autre arpent de large, de Pierre Perthuis, successeur de René Dardenne, le 9 février 1669 (gr. Basset; cf. Adhémar, 14 fév. 1709), et d’une « continuation » de 6 x 15 arpents, le 30 décembre 1686 (gr. Basset) ; en sorte que Julien Belloy pouvait déclarer au
(8 — Variantes. A Clermont on écrivait Belois et Beloys. loy, Au Canada Beloy, Belloys et Bloys (gr. Basset) Beloy, Blois, Bloye, etc.)
recensement de 1681 (Suite, Hist., V, 67e) «1 fusil, 7 bêtes à cornes et 25 arpents en valeur ». Le greffe Adhémar contient en outre, une acquisition d’Urbain Gervaise du 5 novembre 1695. Sur le Plan de l’île de Montréal de 1702, notre colon a une terre de 6 x 35 arpents entre Juillet au N.-E. et Goguet au S.-O.; dans l'Aveu de 1731, à la Longue-Pointe, il possède, entre François Blet et Pierre Goguet, un domaine de 6 x 55 arpents, avec 3 maisons, dont l’une en pierre, 3 granges, 3 étables, 92 arpents de terre labourable et 15 en prairie (RAPQ, 1941, p. 102). Pour atteindre ce degré de prospérité le Sr de Serigny avait eu l’aide d'engagés: Nicolas Joly (gr. Basset, 30 sept. 1671) et Jean Gruet dit Dame Jeanne (gr. Adhémar, 25 juill. 1689). Il avait aussi mis de la terre en fermage: aux frères Lelat, le 2 mai 1688 (gr. Basset) ; à Jacques Desnoyers, le 15 août 1695 (gr. Adhémar) à Dominique Nafrechoux (gr. Lepallieur, 25 nov. 1728 et Jug. Cons. Sup., III, 322; IV, 43). Outre sa terre à la Longue-Pointe, Julien Bloys s’était fait concéder en ville, rue St-Paul, un terrain de 40 pieds de front, aboutissant à la grève, par acte de Basset du 28 juillet 1673 (Terrier, n. 63) : mais il le revendit bientôt (gr. Basset, 22 juin 1676) au taillandier Pierre Roussel. Mentionnons enfin, au sujet de notre homme, un accord avec Julien St-Aubin, son petit-fils (gr. Adhémar, 17 janv. 1703), une donation à Monique Jean, sa belle-soeur (Jug. Cons. Souv., IV, 760) ; et une altercation avec Paul Desmarais qui se régla devant le notaire Adhémar, le 2 août 1687. Bloys et sa seconde femme moururent tous deux à 92 ans; ils furent inhumés à Montréal, lui, le 2 octobre 1730; elle, le 31 octobre 1747. Descendance féminine.
Notes for Julien & Marguerite (Family)
4 enfants de cette union3